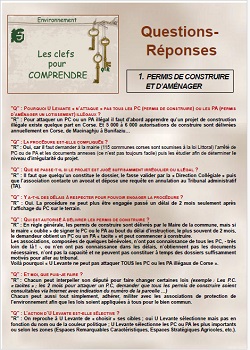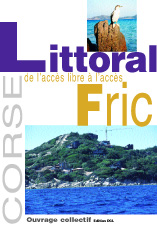Un maître mot : la sobriété.
Le constat est accablant : le développement de nos sociétés s’est fait au prix de pollutions massives, d’une destruction des écosystèmes et d’une consommation de ressources inédite. La Corse, comme le reste de l’humanité, doit ainsi faire face à trois crises imbriquées : un dérèglement climatique (qui sera, en Corse, un réchauffement climatique sur terre mais surtout en mer), une extinction massive du vivant et un épuisement des ressources.
L’inertie climatique est telle que la trajectoire des 30 prochaines années ne peut plus être modifiée : nous paierons les conséquences de notre inaction. La révolution industrielle date du XIX°. Le monde et la Corse, tels que nous les connaissons,ont déjà disparu. Il ne nous reste plus qu’à bifurquer vers un nouveau projet avec une idée directrice en tête : gérer les crises qui s’annoncent dans les 25 prochaines années, et réduire autant que faire se peut l’ampleur de celles des décennies suivantes…
Axes de travail pour une bifurcation écologique de la Corse
En finir avec les « totems* » du passé
Le modèle économique corse basé sur un tourisme exacerbé n’est pas compatible avec un territoire résilient aux futures crises climatiques. Les effets sont nombreux et documentés, et s’ajoutent aux problèmes structurels déjà présents hors période touristique :
- pression mortifère sur les écoystèmes (balbuzards pêcheurs à Scandula, cétacés dans les Bouches de Bunifaziu, ongulés en montagne, euproctes dans les cours d’eau…),
- surproduction de déchets et solutions « techniques » de traitement basées sur les intérêts de quelques entreprises privées, avec pour conséquences une pollution diffuse mais aussi très concentrée aux endroits de stockages,
- surconsommation énergétique et hydrique estivale pour le confort des vacanciers (piscines, golfs, climatisations, établissements touristiques…) entraînant des contraintes fortes sur le dimensionnement des unités de production sur l’Île (centrales au fioul polluantes…),
- surdimensionnement des infrastructures commerciales qui prolifèrent au détriment des producteurs locaux et des commerces de proximité, et qui font la part belle aux produits transformés,
- pratiques touristiques particulièrement impactantes sur l’environnement, notamment les golfs, hélicoptères, yachts, navires de croisière et autres « divertissements » particulièrement consommateurs d’énergie, d’eau et plus globalement de territoires,
- concentration du revenu entre les mains d’une petite partie de la population, avec pour corollaire l’influence maintenant quasi hégémonique d’intérêts mafieux dans l’économie et les « pouvoirs » politique et administratif insulaires.
Aller à l’encontre de ces « intérêts » représente un changement radical dans la gouvernance actuelle de notre ile, mais si la société corse souhaite effectuer cette transition avec un souci de justice sociale et territoriale, il faudra avant tout faire tomber ces « totems » qui ne sont que l’expression locale de la voracité de nos choix sociétaux actuels.
Commencer par ne plus aller dans cette direction, c’est déjà bifurquer vers une Corse plus résiliente et plus juste.
Un nouveau totem : la sobriété pour toutes et tous
Seule une diminution de nos consommations d’énergie et de ressources permettra d’éviter que les bouleversements écologiques ne deviennent ingérables. Il ne s’agit pas ici de s’adapter aux crises à venir, mais de limiter l’augmentation d’ampleurs de celles d’après. Seuls des changements de comportements vers plus de sobriété peuvent permettre d’éviter les effets rebonds : il s’agit d’une condition nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques.
La sobriété n’est pas une démarche négative de renoncement à des consommations indispensables. Elle s’inscrit dans une démarche de hiérarchisation des besoins au niveau individuel et collectif qui vise à réduire les consommations superflues afin de préserver au maximum ce qui compte pour nous.
Ainsi, si le document de l’État en début d’article vise la population en général (en listant tout ce que celle-ci peut déjà faire), il « oublie » tout de même que les personnes à gros revenus sont celles qui contribuent le plus au réchauffement climatique. Il est ainsi juste que ces personnes soient le plus impactées par les futurs efforts que nous allons devoir faire toutes et tous ensemble.
Ainsi le développement de l’activité et de l’accueil des yachts, navires dont l’utilisation est directement liée à des personnes aux revenus très élevés, a pour conséquence de forts rejets de CO2. La Corse ne doit pas devenir une terre d’accueil de ces unités polluantes.
De même il est nécessaire de n’accueillir qu’un nombre très limité (voire nul) de navires de croisière, avec a minima des moteurs n’utilisant que des carburants “agréés” et une répartition concertée des richesses que ceux-ci amènent (c’est-à-dire pas uniquement discutée dans les chambres de commerce). En cas de venue en Corse de ces navires, le coût environnemental de ce passage (pollution atmosphérique et énergétique, destruction des fonds marins, achat d’eau potable…) doit aussi être pleinement compensé par l’établissement de taxes de séjour spécialement dédiées à corriger ces effets négatifs.
Les golfs n’ont pas non plus leur place en climat méditerranéen. De longues périodes sans pluie et quelques épisodes méditerranéens de pluie, n’importe quel « ancien » vous dirait qu’il faudrait être fou pour vouloir faire survivre une pelouse dans ces conditions. Mais c’est actuellement le cas dans ces ilots pour personnes la plupart du temps fortunées.
Améliorer l’autonomie et la résilience alimentaire
« Un projet de résilience alimentaire implique de retrouver une agriculture nourricière, c’est-à-dire répondant au besoin alimentaire du territoire, a minima en fixant des objectifs d’autonomie alimentaire pour différentes denrées de base. Cela implique de faire évoluer une partie de l’activité des exploitations vers la production de ces aliments et de relocaliser les facteurs de production. » (source : association Les Greniers d’Abondance)
Hormis en plaine orientale, aucune microrégion de l’ile n’a actuellement une production alimentaire suffisante pour couvrir les besoins de sa population.
Afin d’améliorer l’autonomie alimentaire de la Corse, les deux ressources essentielles, mais en nombre insuffisant dans beaucoup de micro-régions, sont :
- les terres disponibles. C’est le facteur le plus limitant en Corse, et si le PADDUC a fait un pas en faveur de la protection des terres agricoles avec une protection forte des Espaces stratégiques agricoles (ESA) sur le papier, la réalité du terrain est tout autre et nombre de documents d’urbanisme (PLU, CC ou permis de construire) ont fait fi de ces protections et amputé la possibilité de faire de la Corse une île autonome et résiliente au niveau alimentaire. Il s’agit donc de supplanter les totems actuels par les ESA dans tout futur document structurant (comme lors de la révision du PADDUC). La destination de ces sols ne devrait être qu’agricole (les parcs photovoltaïques de production énergétique doivent y être interdits, comme tout changement de destination).
- les actifs dans une profession aux conditions de travail fortement dégradées. La formation de ces personnes doit être développée et généralisée de toute urgence, notamment aux techniques plus respectueuses de l’environnement telles que l’agro-écologie ainsi qu’à l’adaptation de notre agriculture aux changements climatiques à venir. La question de leur juste rémunération, notamment celle des équilibres avec le secteur commercial et touristique, doit avoir comme axe de décision la justice sociale pour ces productrices et producteurs qui auront rapidement la charge de nourrir l’île dans un environnement toujours plus difficile.
Un urbanisme et des aménagements qui favorisent la résilience de la nature
L’aménagement et l’urbanisme font partie des compétences traditionnelles des collectivités de toutes tailles, sur tous les territoires. Les leviers d’actions à leur disposition dans ces domaines sont nombreux et familiers aux responsables territoriaux. Mais en Corse peu de collectivités se sont saisies des enjeux pour proposer un modèle prenant en compte les futures crises et essayant de limiter l’ampleur de celles d’après.
Les axes en Corse sont principalement :
- limiter les nouvelles constructions aux seules résidences principales,
- décourager fortement la possession de résidences secondaires, re-diriger les résidences secondaires existantes vers de la résidence principale,
- comme l’ont déjà mis en application certaines communes, l’eau douce étant un bien commun, son utilisation domestique et agricole une priorité et sa ressource tarissable, les PLU/CC doivent interdire la construction de nouvelles piscines, décourager l’utilisation des piscines actuelles (taxes spéciales) et surveiller drastiquement le renouvellement de l’eau des piscines existantes en période de sécheresse,
- intégrer la dimension estivale dans la rénovation énergétique du bâtiment, notamment établir un plan de transformation du bâti (isolation, adaptations bio-climatiques…) afin de limiter l’échauffement du bâti et la nécessité de recourir à des pompes à chaleur pour avoir des nuits « vivables »,
- ne plus artificialiser les sols pour limiter les flux impactants des zones d’habitation lors des épisodes pluvieux méditerranéens qui seront de plus en plus fréquents et intenses,
- rendre inconstructibles toutes les parcelles submersibles de bords de mer et appliquer le PADDUC, livret IV, page 84 : « En application de l’article L 146-4-III, les communes peuvent, au sein de leurs plans locaux d’urbanisme, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion côtière le justifient, élargir à plus de 100 m la bande littorale et par conséquent, étendre la protection induite par le principe d’inconstructibilité qui s’y applique. »,
- investir massivement dans les déplacements sans voiture : montée en fréquence des dessertes de la CFC et des autocars de lignes régulières, multiplication des voies douces (pistes cyclables, centres piétons…),
- arrêter d’investir dans des aménagements de voirie automobile,
- arrêter avec les zones commerciales loin des zones d’habitation : retour au commerce de proximité et mise en place de désavantages économiques pour les grosses structures commerciales.
Quelle économie pour une nature résiliente ?
- Abandon du tout-tourisme avec l’arrêt des subventions au développement du secteur touristique et des accords des Chambres de commerce pour favoriser les atterrissages de compagnies low-cost durant la saison estivale.
- Développement d’une filière d’économie circulaire en commençant par une refonte totale de notre gestion des déchets : mise en place d’une stratégie zéro déchets, soutien des acteurs du ré-emploi, mise en place obligatoire de la consigne dans les rayons des commerces de l’île, mise en place d’une taxe à l’entrée sur l’île pour les biens à utilisation unique.
- Soutien au développement d’activités climato-compatibles, notamment la filière bois locale pour la construction et les exploitations agro-écologiques pour l’agriculture.
*Totem : terme usité depuis peu au sens figuré : ” Dans un sens figuré, le mot totem désigne aussi une chose presque considérée comme sacrée, à laquelle une collectivité voue une forme de respect. Un totem, c’est alors quelque chose qu’on ne touche pas, qu’on ne modifie plus, qu’on laisse en l’état. “
 Flux RSS
Flux RSS